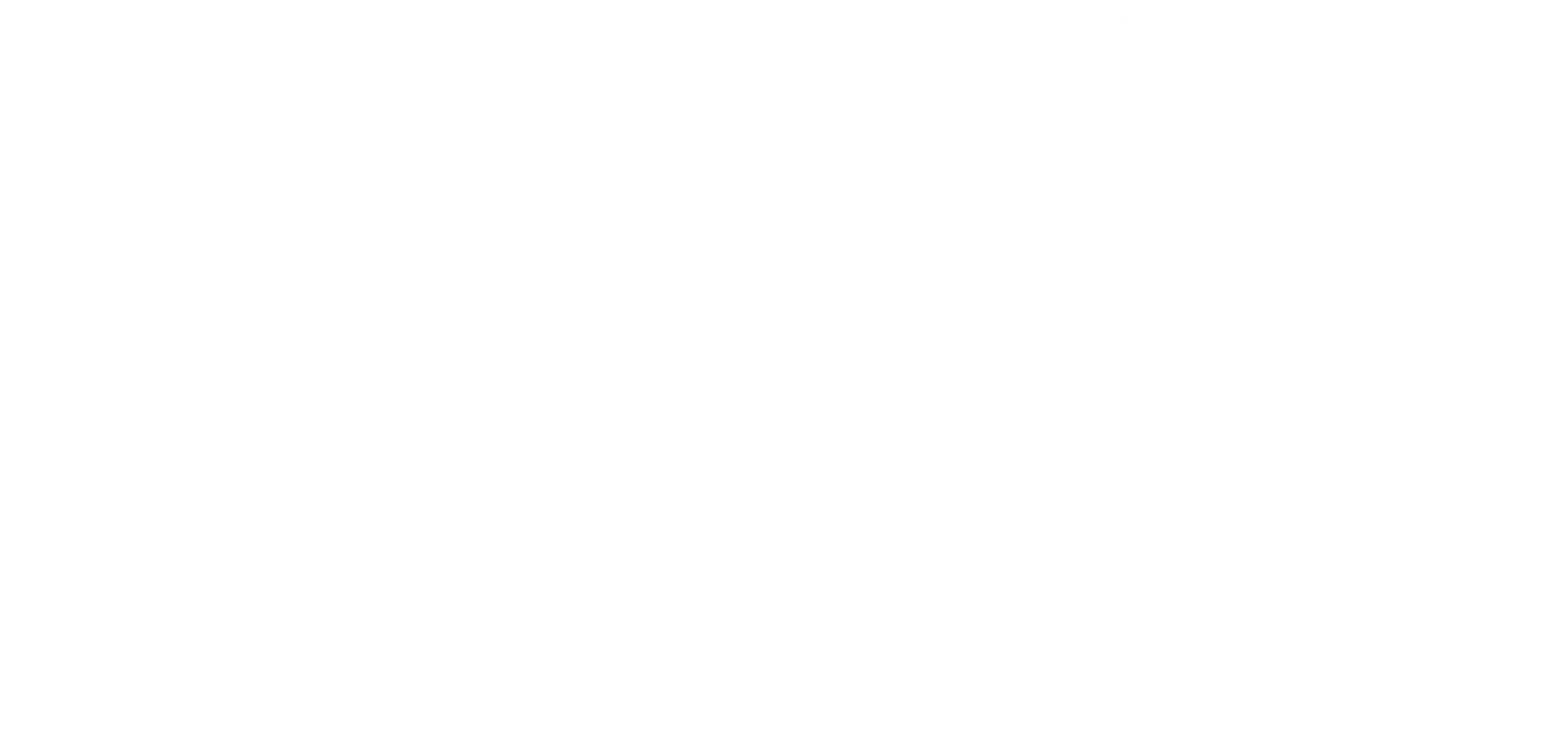Vivre en ville en bonne santé demain, une utopie ?
"La santé est un état de complet bien-être, physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité "
‐ Préambule à la constitution de l'Organisme mondial de la santé (OMS), New-York, 19-22 juin 1946
L’annonce d’un confinement durable le 16 mars 2020 a sonné l’exode urbain temporaire de 1,5 million de Français, selon l’Insee. La pandémie a fortement touché les métropoles, en a modifié les rues, les comportements : les gens sont masqués, restent à distance, dispersés, n’ont accès qu’aux « biens de première nécessité ».
Réinstauré le 17 octobre 2020, l’état d’urgence sanitaire, prolongé jusqu’au 17 février 2021, renforce la question de la vie en ville en bonne santé.
« Une première », dans le baromètre annuel des services publics, publié par l’Institut Paul Delouvrier en 2019, « les Français font de la santé publique leur priorité n°1, devant l’emploi, l’éducation et l’environnement. » Vivre en ville en bonne santé, selon la définition de l’OMS qui fait autorité, depuis 1946, c’est vivre dans « un état de complet bien-être, physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ».
L’état de santé de la population dépend de l’imbrication d’une multitude de facteurs biologiques, comportementaux, socioculturels et environnementaux, ce que l’on appelle les déterminants de santé. La plupart ont une assise territoriale : la qualité de l’air, de l’eau, des sols, l’exposition au bruit, les possibilités d’exercer une activité physique et intellectuelle régulière et d’être en contact avec les autres et avec la nature, par exemple.
L’échelle locale est donc la plus adaptée pour agir et répondre à ces besoins, ce qui avait poussé l’OMS à lancer un réseau mondial de villes-santé dès 1987. « Les villes, considérées comme des organismes vivants, [s’engagent à] agir pour améliorer leur santé et celle de leurs habitants, en envisageant l’environnement comme une ressource fondamentale, à protéger et à enrichir de manière solidaire, dans une perspective aussi bien locale que mondiale. » « Elles donnent à chacun les moyens d’avoir accès à la culture et de réaliser son potentiel de créativité. »
Par le passé, l’urbanisme et l’architecture ont trouvé des solutions pour transformer ces « organismes vivants » à l’aune des épidémies. Le Paris actuel, construit dans les années 1870, vingt-cinq ans après le choléra qui a fait 18 000 victimes en six mois dans la capitale, s’est doté d’avenues plus spacieuses, d’immeubles traversants, de fenêtres plus larges, sous l’impulsion de la pensée hygiéniste.
Aujourd’hui, la crise sanitaire souligne la nécessité d’aborder le lien entre ville et santé de façon plus globale. La crise a rappelé de façon brutale les inégalités de santé au sein de la population en touchant en premier lieu les plus démunis, exposés aux contaminations du fait de leurs conditions de travail, de logement, de nutrition. Rappelons-nous que 13 ans d’espérance de vie séparent les 5% d’hommes les plus riches des 5% d’hommes les plus pauvres en France selon l’Insee.
Nous sommes face à un défi d’intégration des enjeux de santé dans les dynamiques urbaines, aujourd’hui insuffisante. Cela passe par la prise en compte des déterminants de santé dans la conception de nos cadres de vie : comment, à travers nos choix programmatiques ou la conception de nos bâtiments peut-on maximiser l’exposition aux facteurs de protection de la santé et minimiser les facteurs de risque ? Dans trente ans, les deux tiers de l’humanité vivront en ville. Il est urgent de relever ce défi.

Comment construire des cadres de vie bons pour la santé ?
La pandémie a remis la santé au cœur des questionnements des urbanistes et des architectes. « Nous devons revoir nos envies, nos concepts, nos méthodes, nos pratiques, nos manières de coopérer ; en bref, revoir notre conception de l’urbain, de ce qui permet d’être ensemble et de fabriquer du commun. Il nous faut rapidement créer de nouveaux savoir-faire pour accueillir de nouveaux savoir-être et rendre possibles des projets inattendus. » Dans sa livraison de septembre, le journal Nouvelles Urbanités signe la fin du « business as usual ».
L’enjeu, souligne le collectif, n’est pas seulement de construire des espaces plus confortables et plus écologiques. Il s’agit de créer un cadre de vie qui incite les habitants à agir pour leur santé et celle de leur environnement, sans les infantiliser, ni entraver leurs libertés. Reste à savoir comment. Un quartier peut-il changer nos réflexes, construire des citoyens de plus en plus responsables, avec de plus en plus de libertés ? Comment le lieu où nous vivons peut-il nous réapprendre à faire société, ensemble, face aux menaces communes que sont les épidémies et le réchauffement climatique ?
Toutes les compétences sont bienvenues pour répondre à cette question.
FAIRE TRAVAILLER ENSEMBLE LES ACTEURS DE LA FABRIQUE URBAINE, DU MONDE MÉDICAL ET DE L’ENVIRONNEMENT
Co-construire la vision de ce que seraient des « cadres de vie bons pour la santé » avec des experts de tous horizons (urbanistes, architectes, sociologues, collectivités, groupes mutualistes, épidémiologistes, psychologues, pharmaciens, experts ou porteurs de solutions dans les champs du sport, de l’alimentation, des services et espaces médicaux) : c’est la démarche initiée par Bouygues Construction pour partager une ambition commune autour de ces sujets. Comment imaginer des cadres de vie qui aideraient les citoyens à adopter de nouvelles habitudes vertueuses pour la santé, qui auraient un maximum d’impact sur les facteurs de risques associés aux maladies chroniques ou qui contribueraient à résoudre les défis relatifs au système de santé ? Autant d’enjeux explorés lors d’ateliers collaboratifs qui ont donné lieu à la publication « Des territoires favorables au bien-être et à la santé ». La gouvernance des projets fait partie des grands principes clés retenus pour concevoir des quartiers favorables à la santé.
« Mettre en place une instance santé ou un comité scientifique dans le cadre d’un projet d’aménagement ou immobilier, associer en mode concertation des scientifiques, experts de santé et de santé publique, le plus en amont possible, permet d’identifier et de prioriser les enjeux et défis de santé d’un quartier, d’un territoire dans lequel s’inscrit le projet, de définir les leviers d’action adaptés au projet), de mesurer et suivre l’impact du projet sur la santé des populations dans une démarche d’évaluation », explique Elsa Favreau, chef de projet Prospective de Bouygues Construction.
Il s’agit alors de travailler une programmation, avec cette instance, pour infléchir positivement ou mitiger les facteurs de risques : promouvoir une alimentation saine et équilibrée, mettre les corps en mouvement par les mobilités actives et la pratique d’activité physiques, favoriser les interactions sociales et une vie locale riche, organiser les lieux et services de santé au plus près des populations, faciliter l’inclusion des personnes fragilisées par la maladie, le handicap ou la perte d’autonomie et accompagner leurs proches, etc.
Une fois la vision définie, place aux projets. Une vingtaine d’experts de santé (médecins généralistes, médecins du travail, pharmaciens, infirmières de quartier, etc.) associés à un projet immobilier : c’est une expérience innovante menée par un aménageur, Lyon Confluence, et Linkcity, filiale du développement immobilier de Bouygues Construction, pour organiser, de façon collégiale, des lieux et services de santé au plus près des populations, au sein du quartier Confluence de Lyon, au sud de la presqu’île.
Ces approches d’urbanisme favorable à la santé, développées depuis de longues années par le réseau Villes-Santé de l’OMS et par le monde académique, se concrétisent de plus en plus dans les projets et la palette des outils s’étoffe. En témoigne la publication en 2020 du guide Isadora (Intégration de la Santé dans les Opérations d’Aménagement) qui vise à guider les professionnels de la fabrique urbaine dans leurs projets opérationnels.
Au-delà de ces démarches, c’est toute notre conception de l’urbain qui doit être requestionnée en faisant la part belle aux fondamentaux : mieux prendre en compte le vivant et les écosystèmes dans notre façon de construire et concevoir la ville pour tous, y compris les plus vulnérables.
SE METTRE À L’ÉCOUTE DE LA NATURE
« [Il faut] mettre dans l’acte de construire un peu plus de métiers du vivant : ergonomes, écologues, paysagistes, naturalistes, biologistes, pédologues anthropologues, horticulteurs, jardiniers, allergologues, ornithologues, entomologistes, etc. », tweetait en octobre Olivier Lemoine, ingénieur écologue, responsable du pôle biodiversité urbaine d’Elan-France. Des écologues, comme Marc Barra et Philippe Clergeau, rappellent régulièrement l’humilité qu’il est nécessaire d’adopter pour restaurer l’équilibre de l’écosystème dont nous ne sommes qu’une composante : nous n’en retirerons que des bénéfices. La bonne santé des villes en dépend.
Désormais, « à l’université ou dans les écoles d’architecture, la nature infiltre les formations sur la ville », titrait Le Monde du 3 mars 2020. Construire à la verticale, débitumer pour permettre à l’eau de s’infiltrer, cesser de creuser et faire des parkings en silos, planter autant que possible en pleine terre des espèces indigènes, des arbres, notamment qui jouent le rôle de climatiseur urbain grâce à la transpiration végétale, préférer les matériaux biosourcés au béton : autant de pratiques pour lutter contre les épidémies et le réchauffement climatique. Dans ce contexte, la végétalisation des villes est devenue un enjeu de santé publique. La canicule en 2019 a causé pendant l’été une hausse de 10 % des décès.
SE METTRE À L’ÉCHELLE D’UN ENFANT
« Redonner leur place aux enfants dans la ville revient à améliorer la vie quotidienne de chaque adulte, assure Thierry Paquot, dans Bastamag, le 4 mai 2020. C’est aller moins vite, planter plus d’arbres, favoriser des itinéraires fléchés comme pour un jeu de pistes, entretenir les pieds des immeubles, transformer le devant des écoles en parvis colorés et joyeux sans voiture. Il faut penser une autre physionomie de la rue : une ville pour et par les enfants est une ville pour tous. » Une théorie qu’il défend également dans Mesure et démesure des villes (éd. CNRS, 320 pages, 12 mars 2020).
Une démarche poussée par la ville de Bâle, en Suisse, et l’association « Kinder Büro » (le bureau des enfants). Il s’agit non seulement d’inciter les aménageurs à poser un regard différent sur la ville, en plaçant « les yeux à 1,20 mètre » du sol, mais à co-concevoir avec les enfants l’aménagement d’une école, d’une rue, voire d’un quartier, pour que ces espaces publics soient habitables même par les plus vulnérables. Une manière également d’ancrer ses habitants dans le territoire, et de les inciter à en prendre soin.

Quelles villes et quels territoires après la Covid-19 ?
La pandémie de la Covid-19 a agi comme un révélateur des vulnérabilités de la ville : manque de nature, d’espace et d’intimité, et pour certains quartiers, manque d’accès aux produits frais, situations de promiscuité et difficultés d’accès aux soins. Elle en a aussi ses forces : la volonté d’agir et la générosité des habitants et des maires aux initiatives inspirantes.
Les villes que nous connaissons aujourd’hui ont elles-mêmes été forgées par la lutte contre les épidémies et les maladies infectieuses. Les épidémies de cholera, en 1832 et 1849, ont motivé la loi de 1850 sur l’assainissement des logements insalubres et les travaux d’urbanisme dirigés par Haussmann et Belgrand pour aérer, ventiler, purifier la ville : de là sont nés îlots à cours, immeubles traversants, fenêtres élargies, nouveaux parcs et espaces verts et réseaux d’adduction d’eau et d’égouts.
Loin de cette vision hygiéniste, la crise sanitaire est l’occasion de réinterroger nos modèles urbains, d’explorer les leviers susceptibles de les améliorer pour dessiner une ville qui prenne davantage soin de ses habitants.
VILLES NOURRICIÈRES : VERS UNE AUTONOMIE RENFORCÉE
La crise a mis l’accent sur la question de l’approvisionnement alimentaire et de sa logistique. Concernant les denrées alimentaires, le « locavorisme » est passé de phénomène de mode à pratique de bon sens pour la plupart des maires. Amap, boutiques de producteurs, drives-fermiers, marchés ont de beaux jours devant eux. Reste à résoudre le problème du bilan carbone des circuits courts, plus élevé, selon l’Ademe, que les circuits classiques.
Dans un souci d’améliorer leur autonomie alimentaire, des villes comme Paris ou Bordeaux adaptent leurs PLU pour multiplier leurs espaces agricoles.
« Beaucoup ont oublié que Paris a longtemps été une ville agricole, produisant une part de son ravitaillement, explique Audrey Pulvar, adjointe à la maire de Paris, en charge de l’alimentation durable, de l’agriculture et des circuits courts de proximité. Ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que basses-cours et jardins parisiens, des espaces attrayants et diversifiés, ont cessé d’alimenter les habitants.
Aujourd’hui, nous sommes à peine à 10 % des capacités agricoles actuelles de Paris ; elle ne compte que 30 hectares cultivés, des parcelles de 450 à 600 m2 en moyenne, réparties dans différents points de la capitale. »
C’est bien peu quand on sait que « le Paris de Napoléon III [comprenait] 1 400 hectares labourés, 9 000 agriculteurs, 1 700 chevaux de labour et 2 300 vaches recensées, non compris les jardins domestiques », rappelle Jean Favier dans Paris, deux mille en d’histoire (1997). Le Paris d’aujourd’hui ne produit actuellement que 800 tonnes de fruits et légumes ; or « il faut 2 millions et demi de tonnes pour nourrir la capitale. 150 % de la surface de Paris serait nécessaire pour les produire », précise Audrey Pulvar. Il s’agit d’expérimenter, sur tout type de support (murs, toits-terrasses…), de nouvelles formes d’agriculture, comme l’agriculture hors-sol (aéroponie et aquaponie), et permettre aux habitants qui rencontrent des difficultés économiques de se nourrir de la façon la plus naturelle qui soit. Autre levier pour ces territoires métropolitains : coopérer avec des territoires plus ruraux de façon vertueuse. La structuration de filières d’alimentation biologique dans ces territoires peut par exemple être sécurisée par la commande à destination des assiettes parisiennes.
HYBRIDATION DES USAGES
Comment occuper au mieux l’espace au sein des habitations, et dans les lieux publics ?
Mobilité réduite aux déplacements essentiels, récréations d’1 heure maximum dans un cercle d’1 km de son lieu de résidence, télétravail pour une partie de la population : le confinement dans un espace de vie réduit, contrariant notre nature d’êtres de mouvement, a favorisé l’examen de nos habitats et des « arts de faire » – comme disait Michel de Certeau – que nous y développons. Les insatisfactions liées à des logements exigus ou inadaptés au travail à distance, à un accès limité à l’extérieur et à la nature, ont été exacerbés.
« On ne peut plus réfléchir à des appartements qui n’ont ni balcon, ni terrasse, sans accès à l’extérieur, à la nature », affirme l’architecte-urbaniste Anthony Béchu, comme bien d’autres. Par ailleurs « On pourrait réaliser des espaces privés bien plus agréables à vivre en créant des parcours de gendarmes et de voleurs entre les espaces partagés et les espaces intimes ; une porte ouverte entre le salon et la chambre suffit pour s’échapper, réaliser d’autres parcours dans l’appartement. Elle évite de passer par le couloir desservant habituellement chambres et salle de bain. Psychologiquement, c’est un plus ».
Les usages ont été profondément modifiés pendant les périodes de confinement. L’essor du « à distance » a amplifié l’hybridation des usages, au sein du logement : télétravail, éducation à distance, téléconsultation médicale, pratique sportive, artisanat, cuisine, bricolage, etc. Une bonne connectivité et la capacité à moduler ou à réorganiser l’espace pour ces différents usages ont joué un rôle crucial dans le vécu de cette période. Extensions sous formes d’espaces partagés au sein de la résidence dont chaque habitant aurait l’usage sans avoir la propriété, conception des logements pour permettre des lieux de télétravail (alcôves, …) : les besoins sont croissants.
L’expérience de télétravail généralisé (pour les professions avec lesquelles ce mode de travail est compatible) marquera probablement en profondeur les futurs modes d’usage de l’immobilier tertiaire. En conséquence, les sièges sociaux deviendraient des « vitrines » des valeurs de l’entreprise, fédérant ses employés tout en leur assurant plus de flexibilité dans leur organisation et plus d’efficacité.
L’espace public accueille lui-aussi de nouvelles pratiques, leur assurant davantage de souplesse. Pendant le confinement de mars à mai 2020, les rues de Paris, Berlin, New York ou Bogota se sont dotées de davantage de pistes cyclables temporaires ou pérennes, au détriment de voies automobiles, pour réduire la pollution urbaine et les temps de trajet, tout en favorisant l’exercice. Aux beaux jours, les terrasses temporaires ont investi des places de parking ou de livraison. Ces modes d’action urbaine agiles (urbanisme tactique, chrono-urbanisme) ont prouvé leur efficacité dans la gestion de la crise et remettent sur le devant de la scène une approche temporelle de l’urbanisme. Quels que soient les leviers mobilisés (tactique, temporaire, éphémère, réversible, transitoire, chrono), il s’agit d’observer les usages pour repérer des potentiels d’intensification, de désaturation ou d’adaptation et de les organiser en veillant aux équilibres locaux.
VILLE CONNECTÉE
« Avec le confinement et le télétravail, l’utilisation d’internet est de plus en sollicitée, annonce France Info dès le 19 mars 2020. À tel point que des plateformes sont en surchauffe. Faut-il craindre un risque de coupure ? » Malgré une hausse du trafic de 70%, aucune congestion majeure n’a été enregistrée en Europe, rassurait le JDD en mai 2020.
Métropoles ou villes moyennes ont été nombreuses à avoir recours aux solutions digitales pour soutenir l’activité des commerces de proximité en période de confinement. « Le numérique a ainsi permis de faire connaitre les commerces encore ouverts, de faciliter la mise en relation directe entre les producteurs et les consommateurs, ou encore de faciliter la livraison à domicile des produits des commerçants de proximité », explique en juin 2020 la Caisse des Dépôts sur son site. « D’autres solutions peuvent également être imaginées, afin de sécuriser l’accès aux commerces de centres-villes, à l’image, par exemple, d’outils permettant de mesurer la fréquentation des commerces ou encore de gérer les distances de sécurité dans les files d’attente ».
Le téléphone, qui a fait son grand retour pendant le confinement, a aidé les municipalités à gérer les problèmes de leurs ouailles (hormis les urgences médicales et le « traçage », assuré par les services de l’Assurance Maladie et dans une moindre proportion par l’application StopCovid puis TousAntiCovid). La plupart ont mis en place un numéro vert gratuit, disponible parfois 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Dijon l’a intégré au dispositif « OnDijon » qui gère l’espace public grâce à un poste de pilotage centralisé. « OnDijon nous permet d’être résilient face à cette crise, affirmait sur France 3 en avril 2020 Denis Hameau, conseiller métropolitain en charge du projet. On a un dispositif performant et innovant car on a pu prendre soin des personnes isolées. Et dans la fracture numérique et avec les gens en difficultés financières on peut prendre les choses en main. »
Quelle que soit la place de la technologie, la ville intelligente reposera avant tout sur la mobilisation de ses acteurs et de ses citoyens pour « faire territoire », afin de résister à la crise.

Comment vivre mieux en ville ?
Interview croisée de NICOLAS NOTIN, chef de projet santé urbaine et Grand Paris à l’Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France ; ANTHONY BÉCHU, architecte et directeur de l’agence Béchu + associés ; et MAXIME VALENTIN, responsable du développement durable et de l’innovation du projet Lyon Confluence
NICOLAS NOTIN, SI ON MET ENTRE PARENTHESES LA PANDEMIE ACTUELLE, PEUT-ON ESPERER VIVRE LONGTEMPS EN BONNE SANTE A PARIS ?
N.N. : À Paris intra-muros, les indicateurs d’état de santé sont globalement bons. On note une plus faible prévalence de pathologies chroniques, de maladies cardio-vasculaires que dans la plupart des régions françaises. Cependant, il existe d’importantes inégalités sociales et territoriales de santé dans la région : à titre d’exemple entre le 8e arrondissement de Paris et certaines communes du nord parisien nous observons un écart de sept à huit ans d’espérance de vie chez les hommes !
Au-delà de la pandémie actuelle, un des problèmes majeurs reste la pollution atmosphérique. Si on note une stabilisation, voire une légère réduction des taux de polluants (dioxyde d’azote, particules fines et ozone), ils restent toujours élevés au bord des infrastructures comme les routes nationales et départementales. Or, c’est un facteur aggravant ou déclenchant de maladies respiratoires (asthmes, bronchites), et même d’AVC. Les nuisances sonores reviennent neuf fois sur dix parmi les problèmes soulevés par les habitants, mais ne font pas actuellement l’objet d’une ingénierie renforcée.
QUELS PROBLEMES URBAINS LA PANDEMIE A-T-ELLE REVELES ?
N.N. : Les inégalités de santé d’un département à l’autre, fortement corrélées aux inégalités socio-économiques, est un sujet réaffirmé avec force par la crise de la Covid-19. La crise a touché les plus défavorisés, les plus exposés par leurs conditions d’emploi et de logement. La vulnérabilité de la Seine–Saint-Denis face au virus vient de facteurs comme la promiscuité, la surroccupation des foyers d’hébergement (jusqu’à cinq cents personnes vivent dans un foyer destiné à en accueillir deux cents), l’éducation, et l’exercice de métiers ne permettant pas le télétravail.
Par ailleurs, les communes fortement touchées par la Covid-19 sont également touchées par des problématiques de santé publique liées à l’insécurité alimentaire et la nutrition. Les jeunes publics touchés par la surmortalité souffraient dans de nombreux cas d’une comorbidité, comme le diabète ou l’obésité. Or si l’on compare des communes comme Neuilly-sur-Seine et Garges-lès-Gonesse, on constate que la prévalence y est quasiment cinq fois supérieure. Enfin, les territoires vulnérables, avec en première ligne les quartiers de la politique de la ville, souffrent particulièrement des nuisances environnementales (pollution et bruit), de difficultés d’accès à des espaces de ressourcement, et bien évidemment les enjeux de désertification médicale sont plus prégnants.
CES PROBLEMES POURRAIENT-ILS ETRE REGLES PAR L’URBANISME ?
N.N. : Ces questions sont multifactorielles : elles impliquent des évolutions sur l’ensemble des champs de l’action publique, mais les programmes d’urbanisme peuvent largement y contribuer et atténuer les ruptures urbaines et la ségrégation spatiale qui frappent nos territoires. Actuellement en Île-de-France, une trentaine de communes se sont emparé de cette question d’ »urbanisme favorable à la santé » (UFS), avec une vision systémique à long terme touchant au logement, à l’aménagement urbain, aux mobilités. Elles sont venues nous chercher sur les questions globales de santé – lutte contre les nuisances environnementales, promotion de modes de vie sain, accès aux soins et aux services médico-sociaux. Cela nous oblige à travailler ensemble et à nous mettre face à nos responsabilités respectives.
ANTHONY BECHU, COMMENT REPARER CETTE RUPTURE ENTRE PARIS ET SA BANLIEUE ?
A.B. : La capitale s’est ceinturée sans ouvrir ses branches aux villages et aux petites villes avoisinantes. Il faut maintenant les reconnecter, faire du périphérique un vrai boulevard urbain. Il faut remettre de la nature entre ces satellites et la grande ville, leur redonner leur fonction nourricière, recréer des potagers au milieu de Paris. Les paysans doivent avoir le droit de cité, en ville donc. C’est une question de bons sens quand on sait que 80 % de la nourriture mondiale est consommée dans les zones urbaines. Tout le monde est d’accord pour réintégrer la nature en ville et restaurer les écosystèmes. Mais cela ne se fera pas sans problème. La question des centres commerciaux, par exemple, se pose de façon urgente. Que va-t-on faire de ces boîtes à chaussures ? Une de nos équipes réfléchit à la question.
VOTRE FILLE, CLEMENCE BECHU, VOUS QUALIFIE DE MEDECIN DE L’ESPACE. QU’EST-CE QUE CELA SIGNIFIE ?
A.B. : Mon métier consiste à optimiser la vie des gens dans des espaces où ils passent la majeure partie de leur temps : on passe près de 80 % du temps dans un bâtiment ! La rue, la place ou la cour sur laquelle donnent logements ou bureaux, la manière dont on va y implanter la végétation et faire rentrer la lumière, les matériaux, la filtration de l’air, la hauteur sous plafond pour maîtriser la chaleur, les couleurs…, tout cela a un impact sur le bien-être.
On pourrait créer des espaces privés bien plus agréables à vivre en créant des parcours de gendarmes et de voleurs entre les espaces partagés et les espaces intimes. Une porte ouverte entre le salon et la chambre suffit pour s’échapper, réaliser d’autres parcours dans l’appartement ; elle évite de passer par le couloir desservant habituellement chambres et salle de bain. Psychologiquement, c’est un plus. Et il faudrait permettre l’existence d’une pièce supplémentaire, un lieu d’accueil, ou de télétravail, grâce à des subventions ou à la défiscalisation.
Enfin, on ne peut plus réfléchir à des appartements qui n’ont ni balcon ni terrasse, sans accès à l’extérieur, à la nature. Même au bord du périphérique ou d’une autoroute. Ainsi sur le site Spallis, au sud de Saint-Denis, au nord du carrefour Pleyel, nous avons créé un mur pare-bruit côté périphérique, et, côté ville, des cours-jardins sur lesquelles donnent ouvertures et balcons.
COMMENT CONJUGUER RESPECT DE LA BIODIVERSITE ET NOUVEAUX LOGEMENTS ?
A.B. : Les friches industrielles et leurs bâtiments délaissés sont à réinventer. Les terres polluées jouxtant la ville nécessitent des logements en synergie avec la nature pour la faire monter à la verticale sur les murs, les toitures. Et il y a tout un travail à faire pour « débitumiser », « désimperméabiliser » la terre et la régénérer. Il faut renaturer et dépolluer les sols – et l’eau – pour remettre les paysans en ville et permettre aux enfants de voir le ciel bleu. C’est le travail que nous avons initié en 2015 dans l’écocité de Shenyang. C’était tellement pollué au mercure qu’il suffisait de prendre un poisson sous le bras pour prendre sa température !
La nature est un ingénieur qu’il suffit d’imiter pour limiter au maximum notre empreinte écologique, selon les principes du biomimétisme. Nous avons fait monter la tour D2 à la Défense sur un tout petit terrain, entouré de bâtiments, en nous inspirant à la fois de l’arbre et de la nasse, et cela nous a permis d’économiser 30 % de matière : elle s’appuie sur un pilier central, en béton, un tronc d’où partent les branches, les planchers des étages.
L’exostructure – les feuilles de l’arbre –, dans laquelle des pies ont fait leur nid, s’élève pour créer la voûte, un jardin dans les nuages. La végétation s’y est installée ; des champignons et des limaces y vivent à 171 mètres de haut. À partir du 6e étage, il n’y a plus de pollution dans la terre des balcons et des terrasses.
Désormais, il faut également réfléchir à la flexibilité d’un bâtiment. Nous avons créé un atelier chez nous spécialement pour cela. Comment dessiner un bâtiment qui pourrait muer en autre chose ? Il faut redonner de la pérennité à ce qui devient obsolète au fil du temps. Tout raisonnement devra assurer cette flexibilité.
COMMENT FAVORISEZ-VOUS LA VIE D’UN QUARTIER ?
A.B. : Nous redonnons des racines aux lieux et aux êtres qui les ont perdues. Si on implante des gens quelque part sans leur donner des racines identitaires fortes, ils flottent.
On doit créer des lieux où l’on se sente chez soi ; il faut que l’on retrouve sa culture à l’intérieur de son quartier tout en étant raccordé à l’histoire du lieu. C’est fondamental. Ainsi un des grands problèmes futurs de l’Afrique viendra des migrations vers les villes, qui se sont agrandies sur les modèles américains. Or le village, la tribu, l’organisation sociale et sociétale d’où viennent ses futurs occupants appellent un urbanisme différent, pour que le paysan ait droit de cité, et pour que la ville devienne nourricière ; c’est un impératif. Le référent des villes, c’est la culture de ceux qui l’habitent. Louis Kahn, en Inde, a utilisé la brique, les matériaux locaux et les habitants, en arrivant, se sont dit : « C’est à moi, je suis chez moi. »
Ensuite, il faut y assurer une certaine mixité sociale pour gagner en vitalité. Un quartier doit être une petite ville dans la ville. C’est ainsi que nous avons pensé, par exemple, en association avec Alain-Charles Perrot, la Cité internationale de la gastronomie à Dijon, sur le site ancien de l’Hôtel-Dieu, un parc habité, un éco-quartier de 3,5 hectares, comprenant une école d’hôtellerie, des espaces culturels, avec son musée vivant de la gastronomie, des espaces de séminaires, des logements mixtes, des résidences pour les séniors et des espaces de coliving, ainsi que des espaces publics, comme des marchés…
Une réalisation urbanistique et architecturale, c’est comme un menu qui se déguste. Il faut que ce qui se donne à voir, à entendre, à sentir crée une harmonie dans laquelle on se sente bien.
VOUS CONTRIBUEZ DONC A FAIRE « LA VILLE DES PROXIMITES », PRONEE PAR ANNE HIDALGO ?
A.B. : La ville des proximités, on la fait depuis toujours en tant qu’architectes-urbanistes ! Je suis né d’un père et d’un grand-père qui se sont toujours interrogés sur l’usage, sur la fonction, plus que sur la forme et sur ce que le bâtiment va laisser derrière lui. Pour construire un quartier comme un bâtiment, on compose avec l’espace urbain et avec les habitants de cet espace. Dans nos bureaux, on se met à la place des gens en jouant des jeux de rôles de la manière la plus humble possible pour cerner les besoins auxquels nous nous soumettons. Et nous dialoguons avec le maire, les collectivités, on échange avec les habitants. Sans cette concertation, notre travail perdrait en intérêt, car l’échange enrichit également le dessin.
MAXIME VALENTIN, COMMENT AVEZ-VOUS MIS PROGRESSIVEMENT LA SANTE AU CŒUR DU PROJET LYON CONFLUENCE, UN PROJET DE REHABILITATION D’UN QUARTIER CENTRAL ?
M. V. : La question de la santé s’est posée de façon indirecte lorsque la SPL Lyon Confluence a initié le projet Lyon Confluence il y a vingt ans. C’est un quartier de 150 ha à la pointe sud de la presqu’île, au cœur de Lyon, à la confluence de la Saône et du Rhône. En tant qu’aménageurs, nous nous sommes posé la question du bien-être que nous voulions assurer aux habitants, à commencer par la qualité de l’air.
Nous nous sommes livrés à un travail de fond pour restaurer les trames urbaines vertes et bleues, végétaliser le quartier en plantant en pleine terre sur la quasi-totalité des îlots. Il y a une très faible proportion d’espaces souterrains construits. Nous n’avons créé qu’un seul parking en sous-sol, mutualisé, pour libérer les cours, les verdir et lutter contre les îlots de chaleur ; on y mesure l’été une température de 2 à 3 °C inférieure à celle des rues bétonnées. Les bâtiments traversant se ventilent de façon naturelle.
QUELS SERVICES DE SANTE AVEZ-VOUS MIS EN PLACE POUR GARANTIR CETTE QUALITE DE VIE ?
M. V. : Il y a cinq ans, dans le cadre de DIVD (Démonstrateurs industriels de la ville durable) lancé par l’État, nous avons créé Eureka, un consortium qui développe, entre autres axes de réflexion, celui de la santé et du bien-être en ville. Nous avons réalisé, au moment où nous l’avons défini, que nous ne travaillions pas avec le milieu de la santé. Nous avons reçu un accueil très favorable de la part des professionnels que nous sommes allés trouver – l’AST (action-santé-travail), des médecins généralistes, des pharmaciens, des infirmières de quartier – pour monter un projet, ensemble ; mais il restait à le définir. Des maisons de santé, il y en avait déjà à proximité. En revanche, au fil de la discussion, nous nous sommes aperçus que le problème de la prévention n’était pas traité ni structuré.
C’est un des îlots réalisés par Linkcity qui allait porter le projet, un bâtiment de 1 000 m2. Un niveau est consacré à la prévention. Les étages supérieurs accueillent médecins généralistes et infirmières. Alliance Santé, une équipe de trois opérateurs, s’est constituée spécialement pour le projet. Il s’agit d’Office santé – un opérateur de maison de santé –, des radiologues – qui manquaient à l’arrondissement –, et l’AST – la médecine du travail.
Cette synergie entre médecine de ville, médecine du travail et radiologie donne de la profondeur à notre réponse apportée à la question de la qualité de vie, en assurant des services de proximité à la fois de soin et de prévention. La médecine du travail oriente vers les médecins de l’espace de santé des étages supérieurs, ou prend directement les rendez-vous avec eux ; eux-mêmes renvoient au cabinet de radiologie les patients nécessitant un contrôle préventif (du cancer du sein, par exemple). On gagne en temps et en déplacement. Et on économise beaucoup d’énergie.
RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES. Les photos de cet article ont été prises avant la mise en place des mesures sanitaires Covid-19.